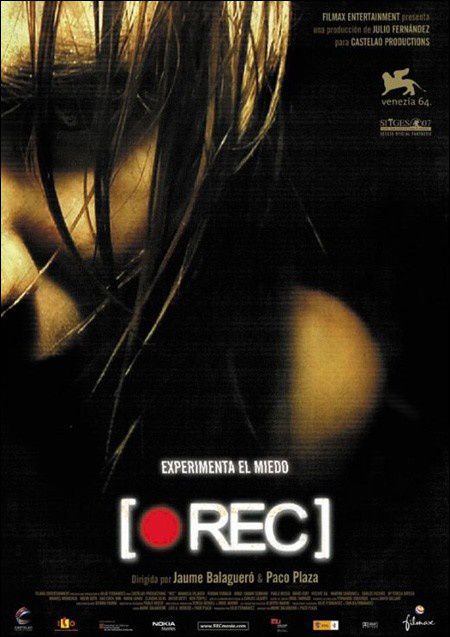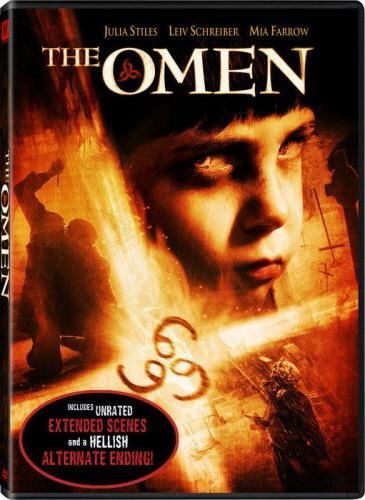.
Il y a très exactement 75 ans, le 22 juillet 1934, John Dillinger, 31 ans, était abattu par les agents du Bureau d’Investigation, futur FBI, en sortant d’un cinéma - conclusion sanglante de treize mois de cavale et de braquages de banque qui en firent "l’ennemi public" de l’Amérique de la Dépression. Michael Mann retrace cette équipée sauvage dans un film somme - somme du genre et de son propre cinéma. C’est que le réalisateur de "Collateral" n’est jamais aussi inspiré que lorsqu’il pose sa caméra du côté des gangsters.
Le pluriel du titre pose apparemment question : qui sont "les" ennemis publics désignés ? Dillinger et ses complices John "Red" Hamilton (Jason Clarke), Homer Van Meter (Stephen Dorff) ou "Baby Face" Nelson (Stephen Graham) ? Ou s’agit-il de Dillinger et de Melvin Purvis, l’agent chargé de le mettre hors circuit ? Avec, respectivement, Johnny Depp et Christian Bale pour incarner ces deux figures, on est d’autant plus tenté de retenir cette option, que Michael Mann a souvent mis en scène le mimétisme entre chasseur et chassé - que l’on se souvienne de "Manhunter", première adaptation d’un roman de Thomas "Hannibal" Harris, ou de "Heat", première confrontation de Robert De Niro et Al Pacino. La véritable guérilla que se menèrent Dillinger et Purvis fut bel et bien publique, Dillinger étant le premier gangster de l’ère des mass media.
Si le scénario prend de nombreuses libertés avec les faits (exemple : "Baby Face" Nelson fut abattu quatre mois plus tard) il n’exagère en rien le feu de l’action. Dillinger et ses pairs inventèrent le grand banditisme, avec armes lourdes et prises d’otages, forçant la loi à répliquer balle pour balle dans de véritables batailles rangées. Mann, comme toujours, excelle dans l’exercice.
Mais "Public Enemies" ne serait qu’un banal film d’action, s’il ne multipliait les sous-textes. Citons l’ouverture du film où une phrase suffit à évoquer la banalité du début du parcours judiciaire de Dillinger (un vol à l’étalage), où un regard résume la loyauté réputée du malfrat et où une séquence dans une ferme désolée explique le statut de héros du braqueur aux yeux d’une population victime de la faillite financière (étrange écho au temps présent). Sans excès de didactisme, le film détaille encore la montée en puissance de J.Edgar Hoover (Billy Cudrup) et de son Bureau d’Investigation, futur état dans l’Etat, avec ses écoutes téléphoniques, ses filatures, ses informateurs et ses méthodes musclées.
Passionnante, aussi, est la mise en perspective de "Public Enemies" avec un genre cinématographique né durant la prohibition (et du vivant de Dillinger), qui remonte à "L’ennemi public" de William Wellman (1931). Joli clin d’œil, Mann montre Dillinger et ses lieutenants se réunissant dans un cinéma où passe à l’écran leur avis de recherche. Et c’est en allant voir un film de gangster - "Manhattan Melodram", où il était cité ! - que Dillinger fut abattu.
Enfin, Mann et son chef opérateur Dante Spinotti parachèvent leurs innovations formelles. Dès "Ali", ils exploitèrent occasionnellement les particularités des caméras numériques HD. Filmé intégralement en numérique, "Public Enemies" bénéficie d’une photographie des plus naturalistes et d’une incomparable profondeur de champ. Partant, Mann renouvelle profondément la grammaire du genre. Qui aurait jamais imaginé un film noir tourné à la flamme des sulfateuses ? Mann l’a fait !

Préférant l’intériorité à la performance mimétique, Johnny Depp et Christian Bale sont parfaits, le premier retrouvant un rôle sombre qui lui va comme un Borsalino. Face à lui, Marion Cotillard achève de séduire Hollywood, gommant son accent "frenchie". L’actrice bénéficie de deux très belles scènes, malgré une romance peut-être un peu forcée (le scénario édulcore la relation de Dillinger avec la prostituée qui l’accompagnait le jour où il fut abattu).
Un futur classique qui, s’il déstabilisera peut-être dans un premier temps, bonifiera sur la durée.
Réalisation Michael Mann. Scénario Ann Biderman, Ronan Bennett. Photographie Dante Spinotti. Montage Paul Rubell et Jeffrey Ford. Musique Elliot Goldenthal. Avec Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, etc.2h10
.