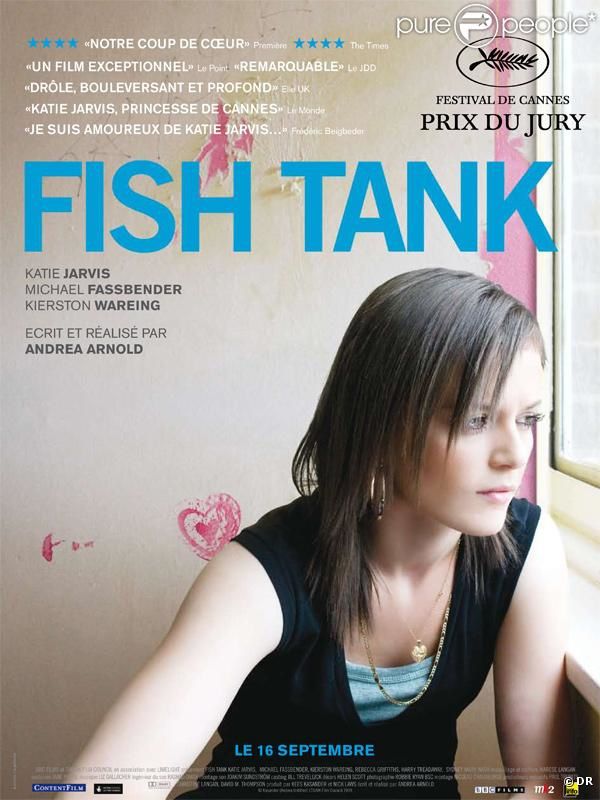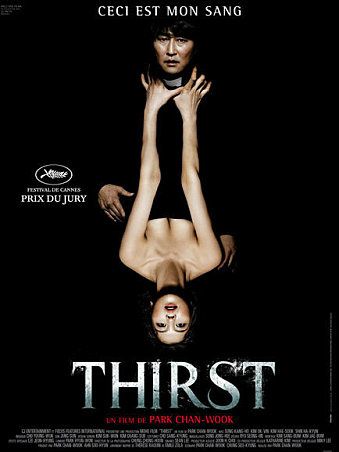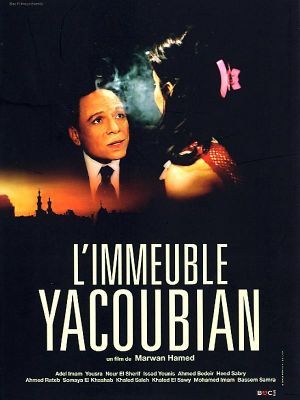Titre français : Printemps, été, automne, hiver ... et printemps
Titre anglais: Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
Titre original : Bom, Yeoreum, Gaeul, Gyeowool, Geurigo, Bom
2003 - Corée du Sud / Allemagne - Drame - 1h43
Réalisation : Kim Ki-duk
Avec : Oh Young-soo, Kim Jong-ho , Seo Jae-kyeong , Kim Young-min et Ha Yeo-jin
Le Réalisateur:
Plutôt confidentiels en Corée, ses films poétiques et violents sont très vite remarqués à l'étranger. L'un des plus réussis, L'Ile, est un grand succès de festival (on le voit notamment à Venise et Sundance), et collectionne les prix. Kim Ki-Duk affirme alors un goût certain pour l'expérimentation. Il tourne Real Fiction, dont le héros est un homme en pleine crise de folie meurtrière, en seulement trois heures et vingt minutes, avec un dispositif de douze caméras.
Address Unknown marque son retour à une forme plus traditionnelle, sur un sujet politique : le film se passe sur une base de l'armée américaine et évoque les traumatismes de la guerre de Corée. La poésie bucolique de Printemps, été, automne, hiver... et printemps finit de l'imposer en Occident, tandis que l'agressif Bad Guy séduit un large public en Corée.
En 2004, au Festival de Berlin, Kim Ki-duk remporte l'Ours d'argent du meilleur réalisateur pour son portrait d'une jeune prostituée, Samaria. Il repart aussi de Venise avec le Lion d'argent pour Locataires, une histoire d'amour quasi muette. Les personnages de Kim Ki-Duk sont silencieux, parce que, explique-t-il, « quelque chose les a profondément blessés. Leur confiance dans les autres a été détruite à cause de promesses non tenues. » Guetté parfois par une dérive esthétisante (L'Arc), le cinéaste nourrit des ambitions internationales, et rêve de réaliser lui-même les remakes français ou hollywoodiens de ses propres films.
Le film:

Dans un temple bouddhiste en bois au milieu d'un lac, vivent un vieux maître zen et son jeune disciple. Les cinq saisons annoncées dans le titre correspondent à cinq chapitres du film où le jeune disciple a respectivement 10, 20, 30, 40 et 50 ans (approximativement). Au fil des saisons, l'élève apprend à vivre par ses erreurs et ses fuites.
Contrairement à ce que l'on est en droit d'imaginer face à un tel résumé, le film n'est pas auto contemplatif. La poésie de l'image et de la musique est certes omniprésente, mais ce n'est pas au détriment de l'histoire qui se construit. Le film utilise une symbolique bouddhiste forte dont une grande partie doit échapper aux occidentaux non-initiés. Parmi ces symboliques, on peut dégager les animaux :
- 1er printemps : chien
- été : coq
- automne : chat
- hiver : serpent
- 2e printemps : tortue
Le film fut diffusé dans le cadre du 6e Festival du film asiatique de Deauville.
Récompenses:
* Prix du Meilleur film lors des Blue Dragon Film Awards 2003.
* Prix du jury Junior au Festival international du film de Locarno 2003.
* Prix Arte/CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d'Art et Essai) au Festival international du film de Locarno 2003.
* Prix Don Quichotte (remis par la Fédération Internationale des ciné-clubs) au Festival international du film de Locarno 2003.
* Prix NETPAC au Festival international du film de Locarno 2003.
* Prix du public au Festival de San Sebastian 2003.
.